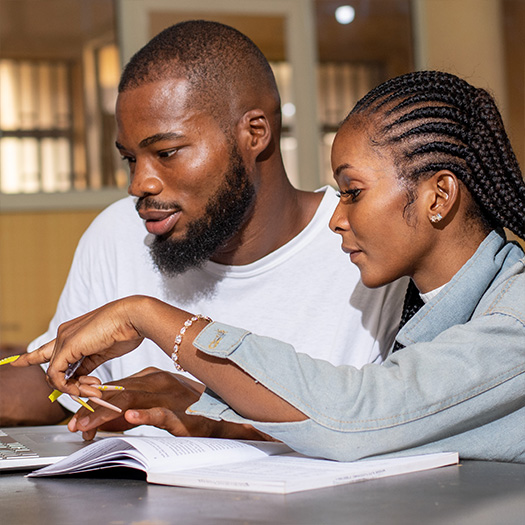Boîte à outils pour les soins de santé sexuelle et reproductive en situation d'urgence (SRH)
Prêt à sauver des vies



Vue d'ensemble
Les fiches d’apprentissage de cette boîte à outils se concentrent sur des thèmes spécifiques de la SSR et fournissent des exemples concrets et des idées. Ces fiches sont élaborées à partir de la littérature, d’études de cas, d’entretiens et d’expériences dans différents pays. Destinés aux décideurs, ils constituent un point de départ pour améliorer l’accès à la santé sexuelle et reproductive dans les situations d’urgence.
Les fiches pédagogiques sont présentées dans l’ordre des étapes de la préparation à la santé sexuelle et reproductive : Initiation, évaluation et mise en œuvre.
Ce dossier renforce la préparation en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR) grâce à des stratégies de collaboration, à une participation significative et à un plaidoyer en faveur de politiques inclusives dans les situations d’urgence.
Principaux enseignements
- Collaboration avec la communauté : Collaborer ouvertement avec les organisations communautaires. Identifier et créer des relations avec les principaux groupes de femmes, de jeunes et d’autres groupes communautaires aux niveaux national et infranational afin d’identifier les besoins spécifiques des populations vulnérables en matière de santé sexuelle et reproductive.
- Une participation significative : Appliquer le principe« ne pas nuire » pour aller au-delà d’une inclusion symbolique. Utiliser des stratégies adaptées pour garantir des décisions éclairées, une participation significative et la représentation des groupes marginalisés et mal desservis dans toutes les activités de préparation en matière de santé sexuelle et reproductive.
- Formation des premiers intervenants : Donner aux premiers intervenants les moyens d’adopter des attitudes non stigmatisantes et leur fournir des informations sur les droits de l’homme, en mettant l’accent sur les droits des femmes, des jeunes filles, des personnes handicapées et des personnes ayant des caractéristiques SOGIESC diverses. Cela les aidera à fournir des services non stigmatisés et fondés sur les droits dans les situations d’urgence.
- Plaidoyer pour des politiques inclusives : Plaider en faveur de politiques de préparation aux situations d’urgence inclusives et assurer une mise en œuvre, une supervision et un suivi efficaces aux niveaux national et infranational.
- Visibilité dans les politiques : Les documents politiques devraient mentionner explicitement les groupes marginalisés et mal desservis, tels que les femmes handicapées, les adolescents et les personnes de diverses SOGIESC, afin de garantir l’inclusion et la visibilité.
L’intégration de la santé sexuelle et reproductive (SSR) et de l’ensemble minimal de services initiaux (EMSI) dans les politiques nationales est cruciale pour les interventions d’urgence. Cette note donne des indications sur la manière de tirer parti des engagements mondiaux pour améliorer les politiques d’urgence en matière de santé sexuelle et reproductive.
Principaux enseignements
- Faire référence aux engagements mondiaux : Utiliser les cadres mondiaux tels que Sendai, Health-EDRM, Sphere et les objectifs de développement durable pour plaider en faveur de l’intégration de la SSR et du DMU dans les politiques nationales, en renforçant les arguments en faveur de réponses globales aux situations d’urgence.
- Analyse contextuelle : Connaître les lois régissant les interventions en cas de catastrophe. Identifier les politiques restrictives pour des groupes spécifiques tels que les adolescents et les réfugiés. Développer des interventions ciblées pour intégrer les dispositions relatives à la santé sexuelle et reproductive.
- Tirer parti des politiques existantes : Mettre en œuvre les politiques du DMU à tous les niveaux et allouer les ressources de manière stratégique afin d’intégrer les politiques de santé sexuelle et reproductive et du DMU pour une réponse opportune en cas d’urgence.
Ce dossier permet aux professionnels de la santé d’intégrer l’ensemble minimal de services initiaux (EMSI) dans les programmes d’enseignement en identifiant les programmes pertinents, en nouant des relations fructueuses et en menant des actions de plaidoyer stratégiques.
Principaux enseignements
- Établir des relations stratégiques : Établir des relations avec les ministères et les établissements de formation compétents qui supervisent le renforcement des capacités dans le domaine des soins de santé. Les sensibiliser à l’importance du DMU et s’assurer de leur soutien pour une intégration efficace.
- Cibler les programmes pertinents : Évaluer les contextes locaux et identifier les programmes les plus pertinents à réviser, tels que ceux de la profession de sage-femme, des soins infirmiers ou de la médecine. Adapter la stratégie d’intégration à des disciplines de soins de santé spécifiques.
- Tirer parti des possibilités de révision des programmes d’études : Restez informé des calendriers de révision des programmes. Saisir le moment idéal des révisions pour plaider en faveur du DMU et l’intégrer de manière transparente dans les programmes éducatifs.
- Explorer d’autres méthodes d’intégration : Évaluer le contexte national et envisager d’autres approches si l’intégration formelle des programmes d’études s’avère difficile ou peu pratique. Assurer la flexibilité nécessaire pour adapter le DMU au paysage éducatif.
- Formation agréée pour les professionnels en activité : Promouvoir la reconnaissance formelle et l’accessibilité des programmes de formation du DMU pour les professionnels de la santé en activité par le biais de l’accréditation et de la reconnaissance dans le secteur des soins de santé.
Il est essentiel de garantir la résilience de la chaîne d’approvisionnement en produits de santé sexuelle et reproductive (SSR), en particulier en cas de catastrophe. Le plaidoyer et la planification sont essentiels pour obtenir rapidement des produits de santé sexuelle et reproductive. Il s’agit d’élaborer des plans de secours pour s’adapter à l’évolution de la demande et aux perturbations.
Principaux enseignements
- Évaluation globale de la communauté : Procéder à une évaluation complète des capacités communautaires actuelles et des besoins en matière de SSR, en accordant la priorité aux populations marginalisées telles que les femmes, les filles, les adolescents, les travailleurs du sexe, les personnes handicapées et les personnes ayant des SOGIESC diverses. Se référer à la note d’inclusion pour des conseils.
- Engagements politiques pour les plans d’action communautaires : Encourager les politiques nationales et infranationales à soutenir les plans d’action qui donnent aux communautés les moyens de relever efficacement les défis liés à la santé sexuelle et reproductive et à l’égalité entre les hommes et les femmes.
- Engagement inclusif des parties prenantes : Impliquer les décideurs politiques, les travailleurs de la santé et la société civile ayant une expérience dans le domaine de la santé dans les sessions de formation du DMU afin d’encourager une collaboration efficace.
- Financement durable de la mise en œuvre : Assurer un financement durable pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des plans d’action communautaires et produire de nouvelles données sur l’efficacité de la préparation à la santé sexuelle et reproductive et à l’égalité des sexes au niveau communautaire, afin de soutenir en permanence les initiatives de résilience.
Ce document présente des stratégies visant à améliorer la résilience des communautés en matière de santé sexuelle et reproductive et de genre, notamment des évaluations complètes, l’engagement des parties prenantes, des engagements politiques durables et le financement d’une mise en œuvre efficace.
Principaux enseignements
- Évaluation globale de la communauté : Procéder à une évaluation complète des capacités communautaires actuelles et des besoins en matière de SSR, en accordant la priorité aux populations marginalisées telles que les femmes, les filles, les adolescents, les travailleurs du sexe, les personnes handicapées et les personnes ayant des SOGIESC diverses. Se référer à la note d’inclusion pour des conseils.
- Engagements politiques pour les plans d’action communautaires : Encourager les politiques nationales et infranationales à soutenir les plans d’action qui donnent aux communautés les moyens de relever efficacement les défis liés à la santé sexuelle et reproductive et à l’égalité entre les hommes et les femmes.
- Engagement inclusif des parties prenantes : Impliquer les décideurs politiques, les travailleurs de la santé et la société civile ayant une expérience dans le domaine de la santé dans les sessions de formation du DMU afin d’encourager une collaboration efficace.
- Financement durable de la mise en œuvre : Assurer un financement durable pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des plans d’action communautaires et produire de nouvelles données sur l’efficacité de la préparation à la santé sexuelle et reproductive et à l’égalité des sexes au niveau communautaire, afin de soutenir en permanence les initiatives de résilience.
Ce dossier vous fournit des stratégies pour construire une base de connaissances communes, établir des partenariats multisectoriels, développer des plans d’action et plaider en faveur de mécanismes de coordination durables.
Principaux enseignements
- Créer une base de connaissances : Veiller à ce que les principales parties prenantes aient une compréhension commune de la santé sexuelle et reproductive dans les situations d’urgence et des normes internationalement reconnues. Utiliser la formation et les orientations du DMU pour accroître la sensibilisation et favoriser une base de connaissances solide.
- Créer des partenariats multisectoriels : Favoriser une approche multisectorielle en engageant des partenaires dans les domaines de la santé, de la gestion des catastrophes et de la technique. Impliquer des organisations communautaires représentant divers groupes.
- Élaborer des plans d’action conjoints : Identifier collectivement les lacunes en matière de préparation à la santé sexuelle et reproductive, en utilisant des outils tels que les évaluations de l’état de préparation du DMU. Formuler un plan d’action commun avec des lignes de responsabilité et des processus de suivi clairs au sein du groupe de travail sur la santé sexuelle et reproductive.
- Envisager la coordination à tous les niveaux : Adapter les mécanismes de coordination à la structure gouvernementale. Établir des relations nationales, infranationales et communautaires afin d’assurer une coordination globale et efficace.
- Apprendre des pairs : Apprendre des pays qui connaissent des situations similaires et partager les enseignements tirés de la mise en œuvre d’activités de préparation à la santé sexuelle et reproductive dans divers contextes.
- Plaider en faveur d’une coordination durable : Institutionnaliser les mécanismes de coordination de la SSR pour une viabilité à long terme. Créer un environnement favorable grâce à des politiques de soutien, des allocations budgétaires et des actions de plaidoyer en faveur de l’intégration de la coordination de la préparation aux situations d’urgence en matière de santé sexuelle et reproductive dans des cadres plus larges.